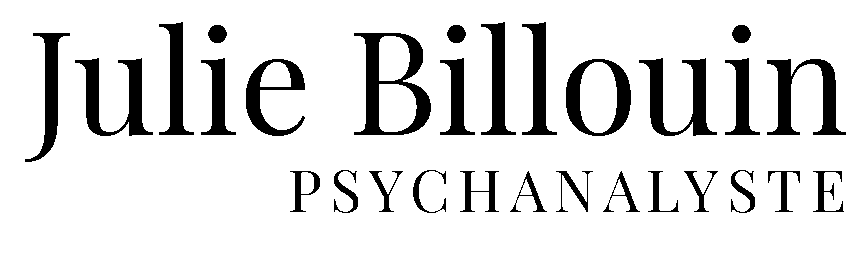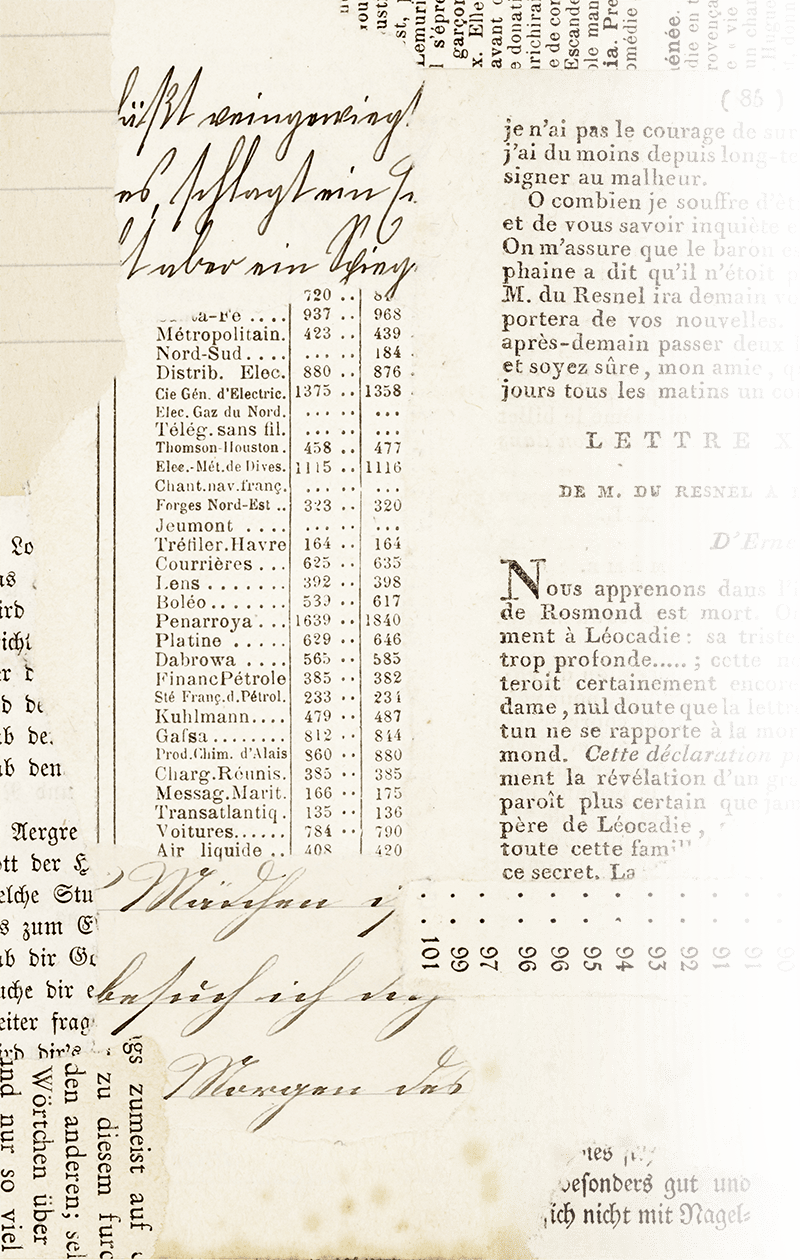
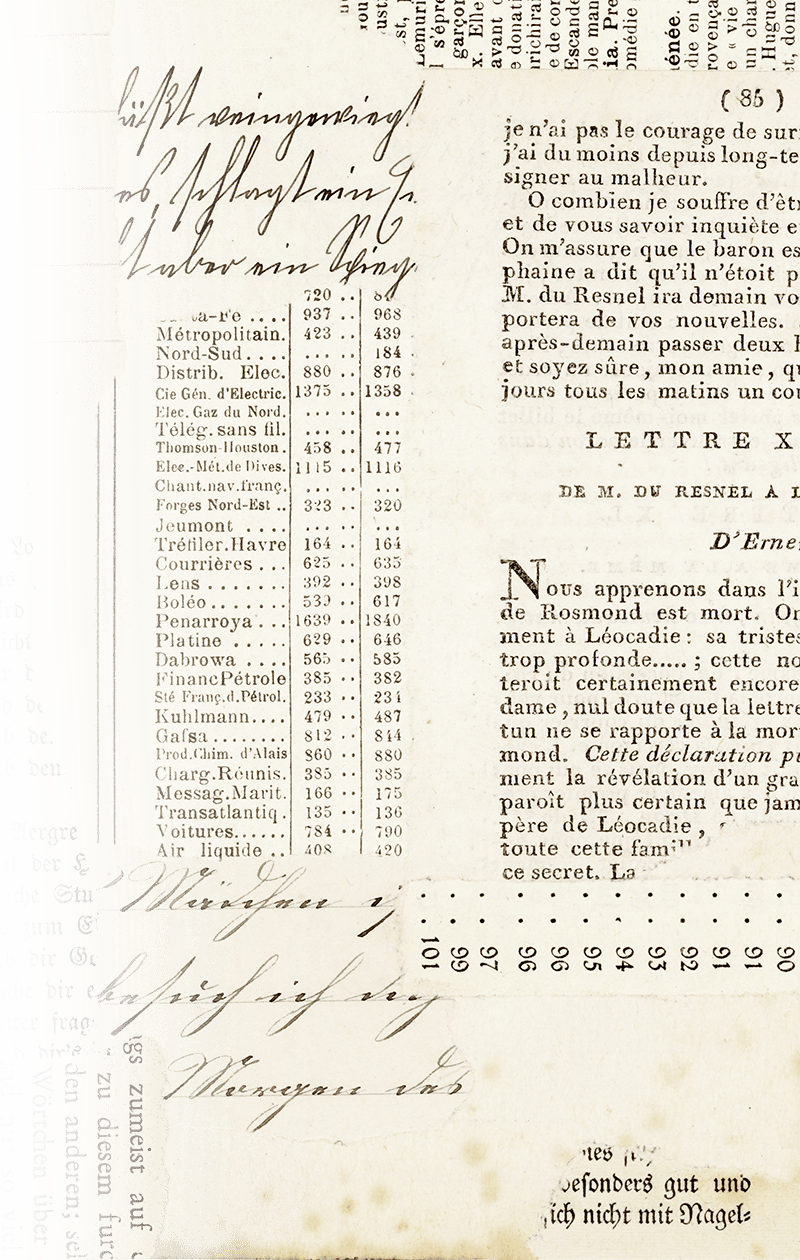
- Accueil
- Ecrits & Publications
- Si le manque m'était conté
Si le manque m'était conté
Si le manque m’était conté…
Julie Mortimore - Avril 2019
Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide ? Nous savons aujourd’hui que cette assertion aristotélicienne n’est pas tout à fait juste. Et l’être, pour quelles raisons a-t-il tant horreur du vide, du manque ? Nous savons, grâce à la psychanalyse, que là où l’être se croit désespéré de manquer, au contraire, il ne manque pas suffisamment pour vivre apaisé.
Que nous apprend notre cycle de colloque sur l’Œdipe ? Et plus encore, que nous apprend la clinique psychanalytique quotidienne sur l’œdipe et la castration ? Destins du Penisneid et de la castration, voilà ce à quoi chaque clinicien qui opère avec l’inconscient est confronté chaque jour, à chaque séance : aux destins de la traversée œdipienne et à ces achoppements. Car s’il consulte, c’est que l’être qui souffre a rencontré maints obstacles durant cette traversée, jusqu’alors inachevée. Son symptôme lui rappelle alors cet inachèvement, lourd de conséquences pour sa vie et souvent son corps, voire son organisme.
Dans son séminaire X « L’angoisse », Jacques Lacan effectue une relecture du texte freudien « Inhibition, symptôme et angoisse » qui déjà, à l’époque, marquait un tournant dans l’œuvre du père de la psychanalyse. Freud y introduisait sa deuxième théorie de l’angoisse : le refoulement ne crée pas l’angoisse mais c’est l’angoisse qui crée le refoulement.
Lacan fait un pas de plus, magistral. L’angoisse n’est pas la conséquence d’un manque, mais d’un manque de manque. Ainsi, il affine et affirme encore davantage ce qu’est l’essence même de la psychanalyse : elle est une clinique du manque.
Ce manque, loin d’être délétère, est l’essence même du désir et ainsi Lacan, lecteur de Freud, fera en ce sens de la psychanalyse une science du désir, probablement la seule discipline scientifique de la subjectivité humaine, non objectivable et non appréhendable par aucun dispositif ou méthodologie d’objectivisation dit scientifique.
Les patients qui arrivent à notre consultation nous évoquent-ils souffrir du manque ou du manque de manque ? Généralement du manque. Car le moi est aliéné. Là est toute la difficulté du clinicien qui doit avoir appris, par sa formation mais surtout par sa psychanalyse personnelle, la complexité du fonctionnent de l’appareil psychique, divisé en différentes instances, elles-mêmes divisées en plusieurs organisations. Et en tant que clinicien, il est essentiel de savoir distinguer qui parle dans le discours du patient, c’est-à-dire à quelle instance psychique avons-nous à faire. Lorsque que l’être croit souffrir d’un manque, il s’agit du moi qui parle, et qui souffre, de toute évidence. Néanmoins, le moi, aliéné par structure, ne dit pas le vrai de la chose. Il lutte pour ne pas manquer et chercher en vain l’objet perdu dont il se croit manquant. Le moi est au service de l’imaginaire. Tout le travail d’une cure, et ce qui demande un certain temps, et de laisser à l’être la possibilité de parler autrement qu’à partir de son moi, s’il accepte, évidemment, de jouer le jeu des associations libres. Ainsi seulement il pourra accéder au vrai, à la parole bien dite, qui tombe, surprend, ne fait pas forcément plaisir mais transforme. Au fur et à mesure de sa cure, ce qui se dévoile est tout autre que ce que l’être croyait savoir. Le manque est certes insupportable, pour le moi, mais ce qui fait souffrir n’est pas cela. La solution ne réside pas en un comblement fantasmatique. Le manque est nécessaire est inhérent à la condition d’être parlant. C’est le manque de manque qui produit ses ravages.
Destins de la castration et du Penisneid suppose la question de que reste-t-il du complexe d’Œdipe ? Autrement dit, a-t-il été suffisamment liquidé ? Le « suffisamment » implique des êtres qui ne soient pas seulement fils ou fille de, frère ou sœur de, mère ou père de, mais des êtres adultes autonomes et indépendants, symboliquement. Le cœur de l’affaire, le détachement, la coupure, est symbolique. Un être peut vivre à des milliers de kilomètres de ses parents, adopter un mode de vie très différent, il n’en est pas pour autant désaliéné de son rapport imaginaire à ses figures parentales. De la même façon que Mr de Amorim évoque dans son séminaire le fait que pour une mère, qui aurait accédé d’abord à la position de femme castrée, son enfant, lorsqu’il nait, est « mort pour elle »[1], je propose que la traversée du complexe d’œdipe suppose que père et mère soient morts pour l’être. Je précise ici, « père et mère » en tant que représentations imaginaires dans l’appareil psychique, « morts » d’un point de vue symbolique. Il s’agit d’abandonner le rapport imaginaire à papa et maman en tant qu’aliénation, dépendance à l’identification imaginaire à l’objet phallique. Les choix, avis, réflexions, méchancetés, intrusions et autres agissements du parent ne comptent plus pour l’être après l’opération psychanalytique. Il n’est plus concerné. Il mène sa vie en toute autonomie. Comme l’écrit Dolto, une fois cette résolution aboutie, « un trait est tiré » entre la vie des parents et celle de l’enfant[2]. Cela vaut pour l’enfant devenu adulte. Voilà pourquoi la période adolescente est une étape charnière et souvent difficile car c’est à ce moment-là, justement, que l’être est appelé à quitter sa position d’enfant et que la différenciation opère avec l’avènement d’un être adulte qui a, de toute évidence, à quitter son premier foyer parental pour aller vivre sa vie et suivre son désir, le sien, pas celui du parent. Cela vaut aussi pour l’être devenu parent, dont les impasses de sa traversée œdipienne débordent sur son comportement et l’éducation prodiguée aux générations futures.
(...)
La psychanalyse, dans son histoire, n’a pas été très tendre avec les mères et les a inculpé de beaucoup de maux, notamment concernant les enfants souffrants. Mon propos ici pourrait y être confondu, alors je prends soin d’apporter quelques précisions à mon propos. Il ne s’agit pas de blâmer, ni culpabiliser les mères, ni les réduire à cette férocité caractéristique de la résistance du surmoi, présente chez tout un chacun. Les organisations intramoïques, à savoir la résistance du surmoi et l’Autre non barré (voir schéma de Mr de Amorim), lorsqu’elles ne sont pas castrées, ont pour conséquence ce genre de débordement dans le quotidien. Il ne s’agit pas de culpabiliser les mères mais de responsabiliser l’être aux prises avec ce grand A non barré. C’est lui, dans le fonctionnement interne de l’appareil psychique qui est responsable de la jouissance maternelle.
Cette distinction permet à la fois de ne renvoyer la faute sur quiconque, y compris les mères, et aussi d’ouvrir à une clinique de l’espérance, car ce grand Autre non barré peut, grâce à la cure psychanalytique, se dégonfler et cesser ses injonctions à l’être de jouir de ce dont il n’a pas à jouir, y compris de son enfant. Comme nous l’indique Françoise Dolto, « le père et la mère, ce doit être clair, attendent le plaisir de leur conjoint, et pas de leurs enfants »[1].
La psychanalyse a depuis longtemps mis en lumière que le symptôme de l’enfant est là pour alerter le parent. L’enfant crie par son symptôme, dit ce qu’il ne parvient pas à dire par les mots, demande la castration de la part du parent qui manque à son poste. Françoise Dolto a remarquablement insisté sur ce point tout au long de son œuvre, le symptôme de l’enfant concerne les parents : « leur enfant n’a rien à faire d’une psychothérapie ; ce sont eux qui en faisaient la demande, parce qu’ils n’étaient pas capables de lui donner la castration[2] ». Elle ajoute même que les entretiens préliminaires, en présence de l’enfant et des parents, sert à la castration des parents eux-mêmes, castration qui puisse leur permettre de voir leur enfant comme un être désirant, tout comme eux. L’intérêt de proposer la cure au parent, « c’est de comprendre l’Œdipe des parents » car « c’est toujours en les ramenant à leur Œdipe que vous comprendrez les projetions pathogènes des parents sur leurs enfants »[3].
Que ce soit la mère qui soit intrusive, le père trop absent, les névroses de l’un ou de l’autre trop bruyantes, l’enfant saura le dire par son symptôme. La place du père est essentielle à saisir si l’on veut capter quelque chose de la symptomatologie d’un enfant. Voilà une belle définition que nous livre Dolto du symptôme : « En fait, le symptôme, c’est la demande : c’est grâce au symptôme qu’on vient demander à l’analyste une aide pour comprendre ce qui se passe ; mais derrière la demande il y a tout un ensemble complexe, condensé dans le symptôme [4]». Ainsi, un destin de la castration, cela peut tout simplement désigner le symptôme, pour celui qui n’a pas suffisamment subi, accepté ou reconnu la castration, comme la conséquence de l’absence de castration. Car l’être souffrira des castrations apportées par la vie, nous dit Dolto, s’ils « ne les ont pas reçues à temps de leur parents »[5].
Elle indique même que la signification des symptômes est à reconnaitre comme le fait que les enfants « sont soumis à la fois à des pulsions sexuelles saines et à l’absence d’une castration structurante venue de leurs parents en réponse à leur appel demeuré incompris »[6].
La névrose apparaît alors lorsque, au lieu de renoncer au désir incestueux, l’être renonce au désir génital.
Le symptôme appelle l’être à se sortir de sa position d’objet phallique, objet fétiche. Pour l’enfant, il faudra que père et mère l’y aident. Pour l’adulte, il devra s’en dépêtrer seul. Mais une psychanalyse peut lui venir en aide. La psychanalyse est la discipline par excellence, et l’unique, qui entend le symptôme comme un appel. La révolution freudienne, si maltraitée de nos jours, a été d’être à l’écoute de ce qui parle dans le symptôme. Et il aura fallu pour cela inventer une méthode, la méthode psychanalytique, pour que puisse « se désigner en parole ce que le symptôme avait pour mission de voiler »[7].
Le clinicien, quant à lui, aura à occuper sa position de semblant d’objet petit a, invention lacanienne pour désigner, au delà de l’objet perdu, le manque qui reste. Il doit incarner la fonction symbolique nécessaire à l’instauration de la castration. La psychanalyse comme discipline et comme méthode thérapeutique a la spécificité et la responsabilité d’indiquer à celui qui souffre qu’il n’est pas obligé d’occuper cette position dans sa vie, position d’objet phallique de la mère, position « d’objet fétiche »[8], qui a pour mission de boucher le manque dans l’Autre, position intenable et insupportable. Il est possible de s’inscrire autrement dans son existence, dans une autre voie possible où le désir, et donc le manque, sont au rendez-vous. La solution suppose un renoncement à « l’identification à l’objet de plaisir et de désir pour l’un et l’autre des parents »[9].
Le renoncement œdipien produit un moi castré de son désir incestueux et un surmoi qui a pour fonction de réveiller l’angoisse de castration au cas où le moi voudrait « ruser avec elle ou se détourner de la loi, même en fantasme »[10].
Le titre de mon intervention, « si le manque m’était conté », m’est venu à l’esprit lorsque, à l’écoute du discours quotidien des patients, et de cette nécessité pour l’être parlant de combler le manque, plutôt que de le vivre comme une nécessité, je me suis demandé comment cela se fait-il que l’être ait tant horreur du manque ? Pourquoi cela demande-t-il autant de temps, de travail, de paroles, pour apprendre à supporter ce manque qui au final, est salutaire ? Quel est ce trait commun universel qui rend le manque détestable ?
Freud, dans « Pulsions et destin des pulsions »[11], nous apprend déjà en 1915 que la pulsion, force constante de l’être dont il ne peut se défaire, a pour but la satisfaction. Et cette satisfaction suppose un objet, ce en quoi et par quoi la pulsion peut atteindre son but. Ainsi, le but de la pulsion est de satisfaire l’objet. Il n’y a dans ce schéma pas place au manque.
Pourtant, par sa rencontre avec le grand A, l’Autre du langage, de la culture, de la civilisation, l’être a à se confronter, déjà bien avant sa naissance, à la castration symbolique que suppose le code du langage. L’être est à la fois fait de ces deux principes là, la pulsion, qui ne connaît pas le manque, et le langage qui induit à la fois l’inconscient, mais aussi la castration symbolique, constitutive du manque à être. Il faudra alors construire une solution pour que cela soit supportable.
C’est la question même de la perte de l’objet qui se rejoue dans une psychanalyse, lorsqu’elle aboutit à la chute de l’objet a. Cette perte de l’objet doit s’incarner dans la vie même de l’être, celui qui accepte de se soumettre à la castration inhérente à la condition d’être parlant. L’objet est perdu à jamais et cette perte, comme nous l’enseigne Rosine Lefort, « nécessaire à la constitution de l’Autre est la substance même de l’inconscient par le refoulement. Le sujet s’y incarne : il y gagne son corps, dans cet objet perdu hors-corps »[12].
Au lieu du comblement et du déplacement métonymique sans fin, la cure psychanalytique amène à supporter le manque. La voie de la jouissance n’est pas celle du désir, voilà ce que m’apprennent les patients quotidiennement. Hier, une patiente parlait de ces relations amoureuses :
« Je reproduis un schéma très destructeur. Un schéma utilisant/utilisé. Plus l’autre fait pression et moins je peux dire non. Comme si j’étais utilisée. Il y a quelque chose en moi, ça me plait, ça m’excite. Je suis passive. Utilisée. Être l’objet de l’autre, être soumise au désir de l’autre, c’est comme si le désir de l’autre se confondait au mien. Mais c’est une situation très angoissante. Mon désir d’être dans cette voie passive est si fort, d’être utilisée, d’être l’objet de l’autre, que j’en oublie que ce n’est pas vraiment ça que je veux. »
La traversée du complexe d’Œdipe, et donc, de la castration, tout comme la traversée d’une cure psychanalytique, consiste à apprendre à quitter une relation duelle, imaginairement fusionnelle, pour intégrer un ordre ternaire, où le Nom-du-père fait loi de castration.
Dolto, avec de nombreux cas cliniques, a su nous montrer comment un enfant fait symptôme en attendant que le mot juste, qu’une vérité lui soit dite. Le symptôme est alors une demande à l’Autre, du mot juste. L’enfant se déguise d’un symptôme que l’Autre parental, à défaut, un psychanalyste, est appelé à décoder. Maud Mannoni nous indique que la parole, ou la non-parole de l’adulte, va « marquer et déterminer les modifications ultérieures de sa personnalité[13] ».
Que représente l’enfant pour la mère dans son monde fantasmatique ? S’il est l’objet de ses projections mais surtout, ce qui lui sert à masquer son propre manque à être, et que le père ne vient pas faire barrage, comment s’en dépêtra-t-il ? C’est tout l’enjeu des cures que nous menons, au quotidien, avec ceux qui ont le courage de venir régler leur compte, symboliquement, avec père et mère.
[1] Dolto F. Séminaire de psychanalyse d’enfants. Tome 1. Éd. du Seuil, Paris, 1982, p. 186.
[2] Dolto F. Séminaire de psychanalyse d’enfants. Tome 2. Éd. du Seuil, Paris, 1985, p. 11.
[3] Ibid., p. 60.
[4] Dolto F. Séminaire de psychanalyse d’enfants. Tome 3. Éd. du Seuil, Paris, 1988, p. 17.
[5] Dolto F. Séminaire de psychanalyse d’enfants. Tome 2. Éd. du Seuil, Paris, 1985, p. 129.
[6] Dolto F. Séminaire de psychanalyse d’enfants. Tome 1. Éd. du Seuil, Paris, 1982, p. 179.
[7] Mannoni M. L’enfant, sa « maladie » et les autres, Le champ freudien, Paris, 1967, p. 9.
[8] Dolto F. Séminaire de psychanalyse d’enfants. Tome 1. Éd. du Seuil, Paris, 1982, p. 142.
[9] Ibid., p. 37.
[10] Ibid., p 240
[11] Freud S. (1915). « Pulsions et destins des pulsions », in Œuvres complètes, vol. XIII, Puf, Paris, 1988, pp. 161-186.
[12] Rosine Lefort citée par Annick Anglade, in L’enfant et la jouissance, Navarin Éditeur, Paris, p. 21
[13] Mannoni M. L’enfant, sa « maladie » et les autres, Le champ freudien, Paris, 1967, p. 36.
[1] Séminaire 2018-2019, séance du 26 février 2019 ; « mort » est à entendre d’un point de vue symbolique, comme ne lui appartenant pas, à la mère. La mère ne possède pas son enfant.
[2] Dolto F. Séminaire de psychanalyse d’enfants. Tome 1. Éd. du Seuil, Paris, 1982, p. 231.
Retrouvez l'intégralité du texte dans la prochaine revue du RPH n°44, à paraître.