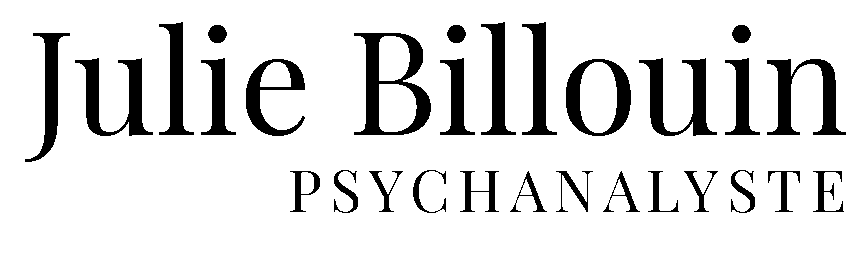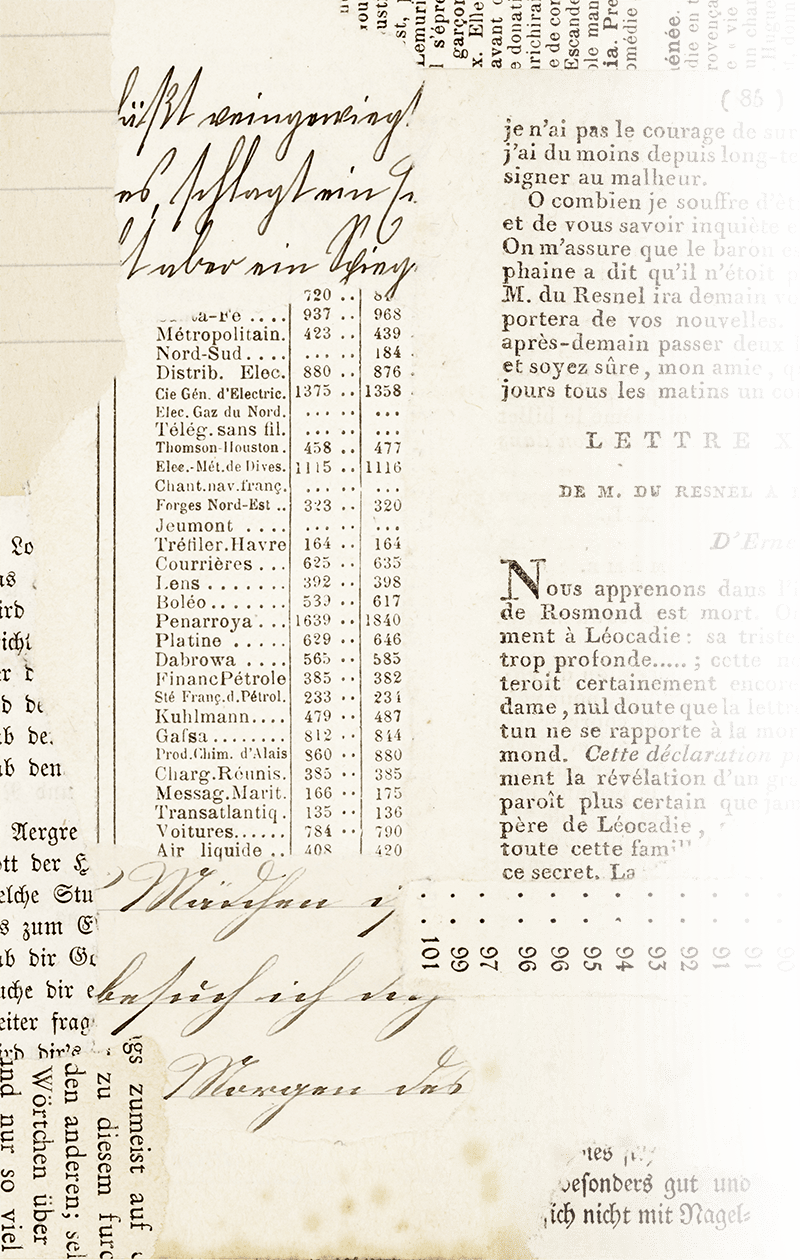
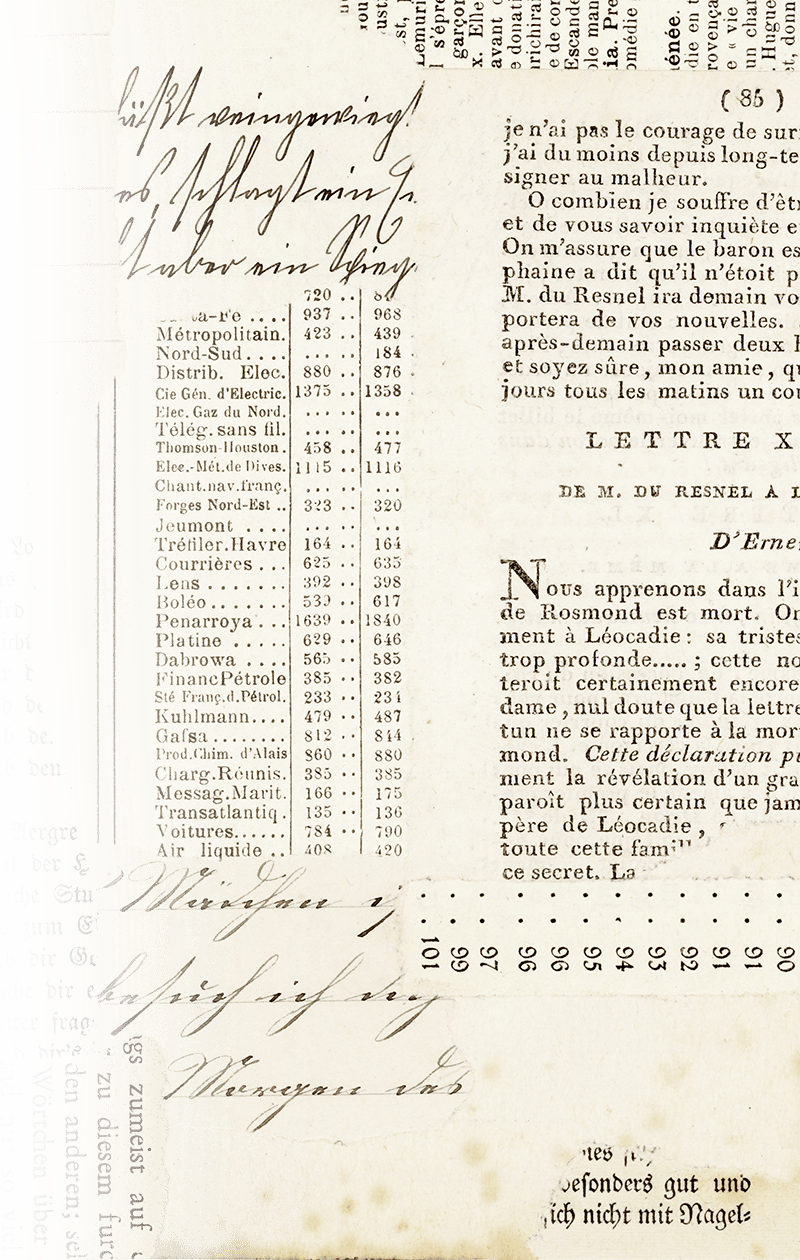
- Accueil
- Ecrits & Publications
- Le travail fait-il souffrir ?
Le travail fait-il souffrir ?
Le travail est-il un outil de réalisation de soi ? Ou bien d’aliénation de soi ? De tout temps, philosophes et autres penseurs ont opposé ces deux possibilités de considérer le travail. Certains estiment que c’est un outil de développement subjectif essentiel, de création, d’autonomie. D’autres considèrent qu’il est un outil d’aliénation, que ce soit par la forme qu’il prend ou tout simplement par la contrainte à travailler que l’homme civilisé s’impose pour vivre en société. Nous savons déjà ce que la psychanalyse nous apprend quant à la contrainte, il n’est pas possible de vivre sans ; elle est inhérente à la vie, à l’être, et même, nous apprit Freud, à la vie psychique et à la sexualité. Est-ce à dire que la contrainte est synonyme de souffrance ? Bien au contraire, il n’y a pas de liberté sans contraintes. Aux premières lueurs de la psychanalyse, certains pionniers eux-mêmes (Otto Gross, Wilhelm Reich) ont succombé au mirage de la liberté et ont tenté de défendre une vision de la vie et de la psychanalyse comme devant se libérer de toutes contraintes. Vaine utopie, le salut de l’âme ne passe pas par là.
Que remarquons-nous dans la clinique quotidienne ? Le travail est un outil indispensable pour mener sa vie convenablement et acquérir une autonomie matérielle et financière mais aussi et surtout, psychique. Par son travail, l’être œuvre à son indépendance. Et qu’y-a-t-il de plus précieux que cela, l’indépendance physique et psychique ? Pourtant, la psychanalyse a mis au jour ce paradoxe curieux, toujours d’actualité et que nous retrouvons chez tout un chacun, celui de refuser, rejeter, saboter ce désir d’autonomie et d’indépendance au prix du symptôme, de la souffrance, voire de la maladie. L’être, en dépit de ce qu’il affirme, ne veut pas grandir, s’émanciper de papa et maman, mener sa vie d’adulte, responsable, autonome. Il a beau dire que c’est bien cela qu’il veut, ce dont il rêve même, être indépendant, mais tout ce qu’il fait lui montre le contraire. Il ne veut pas céder de cet infantile qui lui fait la vie dure. C’est cela la dualité psychique de l’être qui peut devenir un conflit insoutenable. La souffrance au travail peut être une modalité de cette conflictualité psychique.
Freud nous a enseigné très tôt, dès 1904[1], que la visée de la cure était notamment, pour celui qui d’alors souffrait, de recouvrir sa capacité de réalisation et de jouissance. Ceci a donné lieu à une idée freudienne résumée en ces termes : la santé mentale consisterait à être capable d’« aimer et travailler ». L’observation clinique donne raison à Freud, je suis témoin dans ma clinique que ceux qui souffraient dans leur existence et s’en trouvaient empêchés de travailler et d’aimer parviennent à une vie où le travail et l’amour ne riment plus avec douleurs, souffrances ou encore sabotage. La souffrance au travail est un symptôme parmi tant d’autres qui témoigne de la relation tyrannique que l’être s’impose à lui-même. Lorsque le travail devient souffrance, bien souvent, la relation tyrannique de la résistance du surmoi sur le moi est au rendez-vous. D’où vient cette tyrannie ? C’est ce que l’être aura à découvrir dans sa cure, s’il a le courage et le désir de savoir ce qui l’anime véritablement.
Le cas de Mme M. illustre bien ce lien biaisé au travail. Je la reçois en psychanalyse depuis quelques années. Elle arrive à sa séance et annonce qu’elle est en arrêt maladie, sans avoir évoqué auparavant une quelconque souffrance manifeste à son lieu de travail. (...)
Le clinicien doit toujours examiner de près ces question d’arrêt de travail distribué à la va-vite par certains praticiens de la médecine. La psychanalysante se justifie : « C’était trop dur, je ne pouvais pas retourner au travail sans pleurer ». Je lui demande alors de venir chaque jour de la semaine pendant son arrêt maladie. Elle évoque des difficultés financières, je lui demande de se débrouiller et de régler ce qu’elle pourra, mais il est urgent qu’elle vienne dire, ce qu’elle accepte. Cette technique de l’écarteur, proposée par Fernando de Amorim, vise à augmenter ponctuellement le nombre de séances et a pour objectif de rendre au moi une oxygénation nécessaire afin que la psychanalysante puisse se mettre au travail dans sa cure et rependre son exercice professionnel sereinement et au plus tôt. Lorsque j’examine avec elle ce qui se passe, elle parle sa dévalorisation d’elle-même et sa peur de « ne pas y arriver ». Ne pas y arriver à quoi ? Ne pas être à la hauteur de quoi ? Revient toujours le même rapport aliéné et tyrannique de soi à soi-même, qui représente en fait le rapport du moi à la résistance du surmoi et surtout, un moi gonflé d’imaginaire. Cela s’illustre par un sentiment persistant de ne pas être à la hauteur des attentes que l’être se fixe et qui inévitablement renvoie aux attentes prêtées aux autres, voire à l’Autre (paternel ou maternel). La psychanalysante se juge et se critique en permanence, se rabaisse, et cela a pour visée de sabrer son désir. Ce qui est à l’œuvre ici, dans ces paroles malveillantes que l’être s’adresse à lui-même, c’est ce que Fernando de Amorim identifie comme le grand Autre non barré à l’intérieur même du moi. L’être s’épuise au travail et cet épuisement est véritable, il faut le prendre en considération bien évidemment. Le symptôme ne fait jamais semblant. La détresse de cette dame, au début de son arrêt maladie, était criante. Elle était en larmes, épuisée, se sentant seule et incapable d’assumer ses misions professionnelles. Elle reconnaîtra dès la première séance que sa rigidité est en jeu : 90% de son travail se passe bien, 10% non, mais ce sont ces 10% qui sont perçus par le moi et annihilent tout le reste. Il est intéressant d’ailleurs de noter qu’en début de séance, elle me dit ceci juste après m’avoir annoncé son arrêt maladie : « Bien que j’en ai besoin, que je comprenne pourquoi, je savais qu’ici j’en aurai honte ». Qu’est-ce à dire ? Vaut-il mieux que la patiente craque sur son lieu de travail, pleure, pète un plomb ? Bien sûr que non. Elle a entendu une limite à ne pas dépasser et a choisi de s’arrêter, tant mieux. Mais elle n’est pas dupe que ceci n’a pas été parlé en séance, elle n’est pas dupe qu’il s’agit là aussi d’une manœuvre pour ne pas toucher à ce qui la fait souffrir, par ailleurs, à savoir son rapport tyrannique à elle-même et la position qu’elle s’impose, dans son imaginaire, dans sa famille. Et elle n’est pas dupe que celle qui l’écoute ne sera pas d’accord avec cette voie-là de sabotage. Le clinicien n’a pas pour fonction de culpabiliser l’être mais de lui rappeler sa responsabilité. L’être confond bien souvent les deux. Le manque de reconnaissance au travail est une souffrance, voire une plainte, très présente dans nos consultations quotidiennes. Mais quel est ce besoin de reconnaissance de l’autre ? Lorsqu’on examine vraiment les raisons de cette souffrance, il est souvent question d’un compromis que l’être ne veut pas faire. Il veut bien souvent le résultat avant même d’avoir fait ses preuves, ou encore ne pas céder sur des avantages, ou bien se mettre à une place qui n’est pas la sienne (décider à la place de son patron par exemple). Tout ceci concerne des revendications moïques qui n’ont rien à voir avec le travail ; celui-ci devient juste l’arène du conflit psychique interne. Au fur et à mesure de la semaine, la technique de l’écarteur fait son effet : le moi s’apaise, il est moins agité. La vraie question que soulève aussi le travail est la relation au plaisir. Celui-ci est indispensable au travail. S’il est subi, il faut examiner sans tarder là où ça coince. Il y a souvent cette envie, ce fantasme qui revient, de ne pas aller travailler, de ne pas étudier, de ne pas grandir : « Je voudrai rester chez moi, à manger et dormir » me dit cette psychanalysante, tout en sachant que c’est son épuisement qui lui fait dire cela et non pas un désir véritable. Ce qui se révèle aussi régulièrement dans ces situations de rébellion au travail est une demande d’amour insatiable. Ne pas se sentir respecté, apprécié, aimé, cela concerne-t-il vraiment le collègue, le client ou l’employeur ? Il est vrai que Mme B. est en psychanalyse depuis quelques années à présent et cela suppose que son désir de savoir est au rendez-vous. Elle joue le jeu des associations libres et cela produit les effets attendus. Elle découvre notamment dans sa cure sa rigidité et son besoin de tout contrôler qui participent largement de sa souffrance, que ce soit au travail, dans sa vie sentimentale ou tout simplement dans son rapport à elle-même. Au bout de cette semaine, elle a pu reprendre le travail avec sérénité et réaliser que l’ordre qu’elle s’épuisait à mettre en place dans son travail et qui la ronge lorsqu’il n’est pas respecté, la renvoie à un ordre qu’elle s’efforce de mettre en place dans sa famille depuis son enfance. Il est souvent question des responsabilités que l’enfant, même devenu adulte, s’impose pour pallier les difficultés de l’Autre parental qui ne joue pas son rôle. L’enfant n’a pas à réparer quoi que ce soit. Si l’autre ne fait pas bien, pas assez, pas comme souhaité, c’est ainsi et cela lui appartient, au parent, pas à l’enfant. Le travail de la cure viendra apprendre à se détacher et se différencier. Jacques Lacan[1] nous avait signalé à quel point l’être se heurte à reconnaitre la castration de l’Autre, et par là même, la sienne propre. Cela a donné lieu à de merveilleuses séances pour cette psychanalysante, sur son lien à sa famille, au rôle qu’elle se donne, à sa difficulté à grandir et à assumer sa féminité.
Le clinicien doit toujours examiner de près ces question d’arrêt de travail distribué à la va-vite par certains praticiens de la médecine. La psychanalysante se justifie : « C’était trop dur, je ne pouvais pas retourner au travail sans pleurer ». Je lui demande alors de venir chaque jour de la semaine pendant son arrêt maladie. Elle évoque des difficultés financières, je lui demande de se débrouiller et de régler ce qu’elle pourra, mais il est urgent qu’elle vienne dire, ce qu’elle accepte. Cette technique de l’écarteur, proposée par Fernando de Amorim, vise à augmenter ponctuellement le nombre de séances et a pour objectif de rendre au moi une oxygénation nécessaire afin que la psychanalysante puisse se mettre au travail dans sa cure et rependre son exercice professionnel sereinement et au plus tôt. Lorsque j’examine avec elle ce qui se passe, elle parle sa dévalorisation d’elle-même et sa peur de « ne pas y arriver ». Ne pas y arriver à quoi ? Ne pas être à la hauteur de quoi ? Revient toujours le même rapport aliéné et tyrannique de soi à soi-même, qui représente en fait le rapport du moi à la résistance du surmoi et surtout, un moi gonflé d’imaginaire. Cela s’illustre par un sentiment persistant de ne pas être à la hauteur des attentes que l’être se fixe et qui inévitablement renvoie aux attentes prêtées aux autres, voire à l’Autre (paternel ou maternel). La psychanalysante se juge et se critique en permanence, se rabaisse, et cela a pour visée de sabrer son désir. Ce qui est à l’œuvre ici, dans ces paroles malveillantes que l’être s’adresse à lui-même, c’est ce que Fernando de Amorim identifie comme le grand Autre non barré à l’intérieur même du moi. L’être s’épuise au travail et cet épuisement est véritable, il faut le prendre en considération bien évidemment. Le symptôme ne fait jamais semblant. La détresse de cette dame, au début de son arrêt maladie, était criante. Elle était en larmes, épuisée, se sentant seule et incapable d’assumer ses misions professionnelles. Elle reconnaîtra dès la première séance que sa rigidité est en jeu : 90% de son travail se passe bien, 10% non, mais ce sont ces 10% qui sont perçus par le moi et annihilent tout le reste. Il est intéressant d’ailleurs de noter qu’en début de séance, elle me dit ceci juste après m’avoir annoncé son arrêt maladie : « Bien que j’en ai besoin, que je comprenne pourquoi, je savais qu’ici j’en aurai honte ». Qu’est-ce à dire ? Vaut-il mieux que la patiente craque sur son lieu de travail, pleure, pète un plomb ? Bien sûr que non. Elle a entendu une limite à ne pas dépasser et a choisi de s’arrêter, tant mieux. Mais elle n’est pas dupe que ceci n’a pas été parlé en séance, elle n’est pas dupe qu’il s’agit là aussi d’une manœuvre pour ne pas toucher à ce qui la fait souffrir, par ailleurs, à savoir son rapport tyrannique à elle-même et la position qu’elle s’impose, dans son imaginaire, dans sa famille. Et elle n’est pas dupe que celle qui l’écoute ne sera pas d’accord avec cette voie-là de sabotage. Le clinicien n’a pas pour fonction de culpabiliser l’être mais de lui rappeler sa responsabilité. L’être confond bien souvent les deux. Le manque de reconnaissance au travail est une souffrance, voire une plainte, très présente dans nos consultations quotidiennes. Mais quel est ce besoin de reconnaissance de l’autre ? Lorsqu’on examine vraiment les raisons de cette souffrance, il est souvent question d’un compromis que l’être ne veut pas faire. Il veut bien souvent le résultat avant même d’avoir fait ses preuves, ou encore ne pas céder sur des avantages, ou bien se mettre à une place qui n’est pas la sienne (décider à la place de son patron par exemple). Tout ceci concerne des revendications moïques qui n’ont rien à voir avec le travail ; celui-ci devient juste l’arène du conflit psychique interne. Au fur et à mesure de la semaine, la technique de l’écarteur fait son effet : le moi s’apaise, il est moins agité. La vraie question que soulève aussi le travail est la relation au plaisir. Celui-ci est indispensable au travail. S’il est subi, il faut examiner sans tarder là où ça coince. Il y a souvent cette envie, ce fantasme qui revient, de ne pas aller travailler, de ne pas étudier, de ne pas grandir : « Je voudrai rester chez moi, à manger et dormir » me dit cette psychanalysante, tout en sachant que c’est son épuisement qui lui fait dire cela et non pas un désir véritable. Ce qui se révèle aussi régulièrement dans ces situations de rébellion au travail est une demande d’amour insatiable. Ne pas se sentir respecté, apprécié, aimé, cela concerne-t-il vraiment le collègue, le client ou l’employeur ? Il est vrai que Mme B. est en psychanalyse depuis quelques années à présent et cela suppose que son désir de savoir est au rendez-vous. Elle joue le jeu des associations libres et cela produit les effets attendus. Elle découvre notamment dans sa cure sa rigidité et son besoin de tout contrôler qui participent largement de sa souffrance, que ce soit au travail, dans sa vie sentimentale ou tout simplement dans son rapport à elle-même. Au bout de cette semaine, elle a pu reprendre le travail avec sérénité et réaliser que l’ordre qu’elle s’épuisait à mettre en place dans son travail et qui la ronge lorsqu’il n’est pas respecté, la renvoie à un ordre qu’elle s’efforce de mettre en place dans sa famille depuis son enfance. Il est souvent question des responsabilités que l’enfant, même devenu adulte, s’impose pour pallier les difficultés de l’Autre parental qui ne joue pas son rôle. L’enfant n’a pas à réparer quoi que ce soit. Si l’autre ne fait pas bien, pas assez, pas comme souhaité, c’est ainsi et cela lui appartient, au parent, pas à l’enfant. Le travail de la cure viendra apprendre à se détacher et se différencier. Jacques Lacan[1] nous avait signalé à quel point l’être se heurte à reconnaitre la castration de l’Autre, et par là même, la sienne propre. Cela a donné lieu à de merveilleuses séances pour cette psychanalysante, sur son lien à sa famille, au rôle qu’elle se donne, à sa difficulté à grandir et à assumer sa féminité.
Un autre psychanalysant se rend compte récemment dans sa cure que les frustrations et colère qu’il accumule au travail, notamment parce que son chef lui refuse sa demande d’augmentation, sont bien liés à quelque chose qui n’a rien à voir avec son travail. Il se démène, en fait plus que ce qu’il n’en faut, s’épuise même parfois au travail et demande ensuite reconnaissance pour des efforts qui ne lui sont pas demandés. Évidemment, le refus de son chef ne fait qu’augmenter sa colère. En séance, il réalise alors que cette demande à gagner plus, alors qu’il vit déjà confortablement, prend source non pas dans un réel désir qui lui serait propre mais à partir d’une culpabilité et d’un souhait d’aider financièrement sa famille. Un père qui n’a jamais vraiment travaillé et vit au crochet de la mère, des frères et sœurs qui galèrent dans leur vie professionnelle, et voilà qu’il veut venir pallier cela en les aidant financièrement. Autrement dit, il n’assume pas sa réussite professionnelle et culpabilise en comparaison à la trajectoire du reste de sa famille. Ici aussi le clinicien est amené à intervenir pour tenter de castrer cette résistance du surmoi qui s’acharne sur le moi. Monsieur se tue à la tâche, rentre frustré, énervé, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur son sommeil, son estime de lui-même, ses relations avec sa compagne. Je lui demande alors « Vous êtes en train de dire que vous souhaitez gagner plus pour aider votre famille ? Avec votre argent, que vous gagnez durement ?! ». La prise de conscience est parfois rude, mais nécessaire. Et pourtant, elle seule ne suffira pas à faire changer durablement les choses, mais c’est un début. Le moi est déjà moins aveugle mais pour que cela puisse donner lieu à une véritable transformation, il faudra que l’être découvre vraiment ce qui l’anime dans cette façon de vouloir pallier les soucis de l’autre, de ne pas vouloir se détacher de sa famille, ne pas assumer une vie confortable à l’inverse de ses parents. La séparation n’est pas encore au rendez-vous et encore moins la castration qui suppose une coupure véritable entre le sujet et l’Autre parental. C’est cette dernière, lorsqu’elle est éprouvée, qui permet à l’être de dire « ça, ça les concerne, ce ne sont pas mes affaires ». À partir du moment où l’être s’interroge sur sa part de responsabilité et non celle du voisin, il y voit plus clair : il fait un travail qui ne lui est pas demandé, il demande à ce que ce soit reconnu, et quand ce n’est pas le cas, il s’énerve et est prêt à tout remettre en question. Ce qui le pousse à en faire autant n’est rien d’autre qu’un désir qui vise son rapport à sa famille, aliéné, non différencié, une position infantile, qui n’a rien à voir avec son rapport au travail mais qui lui y porte pourtant préjudice.
Beaucoup de patients qui nous rendent visite et qui souffrent dans leur rapport au travail souffrent en fait d’un rapport autre qui infuse et pollue leur relation au travail. Le travail de la cure a pour visée de débroussailler, nettoyer, faire place nette. Souffrir au travail n’est pas une fatalité. Le travail est d’une préciosité immense, il donne à l’être toute son autonomie financière, un statut social, une possibilité d’apprendre, de création, bref, une dignité et une voie pour grandir. Et s’il arrive que l’environnement professionnel soit néfaste, et ce peut être le cas - l’être n’est pas responsable de tout, seulement de lui-même, et c’est largement suffisant - une fois que celui-ci a fait le tour de ce qui le concerne, il doit pouvoir se positionner et quitter cet environnement-là et construire une solution pour s’en extirper au plus vite (changement de poste, d’entreprise, de façon de travailler). Il appartient à l’être de s’en dégager. La psychanalyse ne change pas le monde, les parents, la société tels qu’ils fonctionnent. Elle change l’être et son rapport au monde, à ses parents, à ses enfants, à son employeur etc. et c’est déjà immense. Cela suffit à supporter ce qui ne dépend pas de lui. Si l’être reste dans une situation qu’il sait stressante, inconfortable, voire malveillante, il a sa part de responsabilité. Il n’y a aucune raison de s’imposer une telle situation, si ce n’est par besoin d’autopunition, ce que nous identifions comme l’action de la résistance du surmoi. Le moi est aliéné, il veut subir. Or, une construction nouvelle est toujours possible. Là est l’action efficace de la cure psychanalytique, soutenir l’être dans cette construction nouvelle qu’il a à établir. Je pense ici aux cas d’une patiente qui souffrait au travail mais ne voulait rien céder de son « confort » (horaires, habitudes, collègues) au prix d’angoisses et conséquences sur sa vie psychique, corporelle mais aussi familiale et conjugale. (...)
Beaucoup de patients qui nous rendent visite et qui souffrent dans leur rapport au travail souffrent en fait d’un rapport autre qui infuse et pollue leur relation au travail. Le travail de la cure a pour visée de débroussailler, nettoyer, faire place nette. Souffrir au travail n’est pas une fatalité. Le travail est d’une préciosité immense, il donne à l’être toute son autonomie financière, un statut social, une possibilité d’apprendre, de création, bref, une dignité et une voie pour grandir. Et s’il arrive que l’environnement professionnel soit néfaste, et ce peut être le cas - l’être n’est pas responsable de tout, seulement de lui-même, et c’est largement suffisant - une fois que celui-ci a fait le tour de ce qui le concerne, il doit pouvoir se positionner et quitter cet environnement-là et construire une solution pour s’en extirper au plus vite (changement de poste, d’entreprise, de façon de travailler). Il appartient à l’être de s’en dégager. La psychanalyse ne change pas le monde, les parents, la société tels qu’ils fonctionnent. Elle change l’être et son rapport au monde, à ses parents, à ses enfants, à son employeur etc. et c’est déjà immense. Cela suffit à supporter ce qui ne dépend pas de lui. Si l’être reste dans une situation qu’il sait stressante, inconfortable, voire malveillante, il a sa part de responsabilité. Il n’y a aucune raison de s’imposer une telle situation, si ce n’est par besoin d’autopunition, ce que nous identifions comme l’action de la résistance du surmoi. Le moi est aliéné, il veut subir. Or, une construction nouvelle est toujours possible. Là est l’action efficace de la cure psychanalytique, soutenir l’être dans cette construction nouvelle qu’il a à établir. Je pense ici aux cas d’une patiente qui souffrait au travail mais ne voulait rien céder de son « confort » (horaires, habitudes, collègues) au prix d’angoisses et conséquences sur sa vie psychique, corporelle mais aussi familiale et conjugale. (...)
À partir du moment où un être souffre dans son existence, et que cela l’empêche de mener sa vie, le clinicien sait que, dans l’appareil psychique, s’est installé un fonctionnent tel qu’il faudra un véritable travail de fond pour que les instances psychiques en jeu puisse recouvrer leur fonction. Le temps, plus ou moins long, d’une cure, se légitime à partir de ce constat-là que le moi est aliéné à un point tel qu’il enferme l’être dans une vision erronée, morbide, stressante de la réalité. En plus de cette aliénation, le moi subit la pression de la résistance du surmoi qui elle, témoigne de la culpabilité inconsciente dont il aura à se défaire. L’être trouve une voie de punition par la résistance du surmoi et pour que le moi et la résistance du surmoi puissent se dégonfler, il faudra se soumettre à la méthode psychanalytique qui œuvre à la désaliénation des ces instances psychiques débordées. Du point de vue du moi, c’est une soumission à laquelle il doit parvenir, grâce au désir de l’être parlant. Ainsi, mon propos est de défendre l’idée que ce n’est pas le travail qui est aliénant mais le rapport de l’être à lui-même et au monde qui est aliéné. Il ne fait pas exprès, ce n’est pas volontaire, comme j’entends souvent dans mes consultations. Bien évidemment, et c’est là toute la complexité à entendre du fonctionnement même de la psyché. Cependant, nous sommes responsables quand bien même nous ne faisons pas exprès. Ne négligeons pas l’enseignement freudien d’il y a plus d’un siècle à présent, ne faisons pas comme si rien n’avait été énoncé et démontré quant au fonctionnement de l’appareil psychique : le moi n’est pas le maître dans sa propre maison, l’être ne se réduit pas au conscient. Toute sa complexité et sa singularité sont à entendre, et qui est plus à même de le faire que le psychanalyste ? Et lorsque le grand Autre barré qu’incarne le psychanalyste signale que souffrir, « ce n’est pas obligé » - et là est la fonction du psychanalyste d’intervenir au niveau des organisations intramoïques – l’être a sa part de responsabilité dans le fait de rester dans un conflit ou un milieu toxique ou encore ne pas vouloir abandonner sa souffrance, autre nom de sa jouissance. L’être a beau dire qu’il sait, c’est-à-dire qu’il n’ignore plus consciemment, il ne parvient pas pour autant à faire autrement. Savoir véritablement suppose de savoir faire autrement. Sinon, c’est croire savoir, et il s’agit toujours du moi aliéné.
[1] « Ce devant quoi le névrosé recule, ce n’est pas devant la castration, c’est de faire de sa castration ce qui manque à l’Autre. C’est de faire de sa castration quelque chose de positif, à savoir la garantie de la fonction de l’Autre […] À cette place manquante, le sujet est appelé à faire l’appoint par un signe, celui de sa propre castration. » Lacan, J. Le séminaire, livre X. L’angoisse, Paris, Ed. Du Seuil, 2004, p. 58
[1] Freud, S. (1923). «Psychanalyse et théorie de la libido», in Œuvres complètes vol. XVI, Paris, Puf 1991, p.200-201.
Me contacter
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
Écrire à Julie Billouin